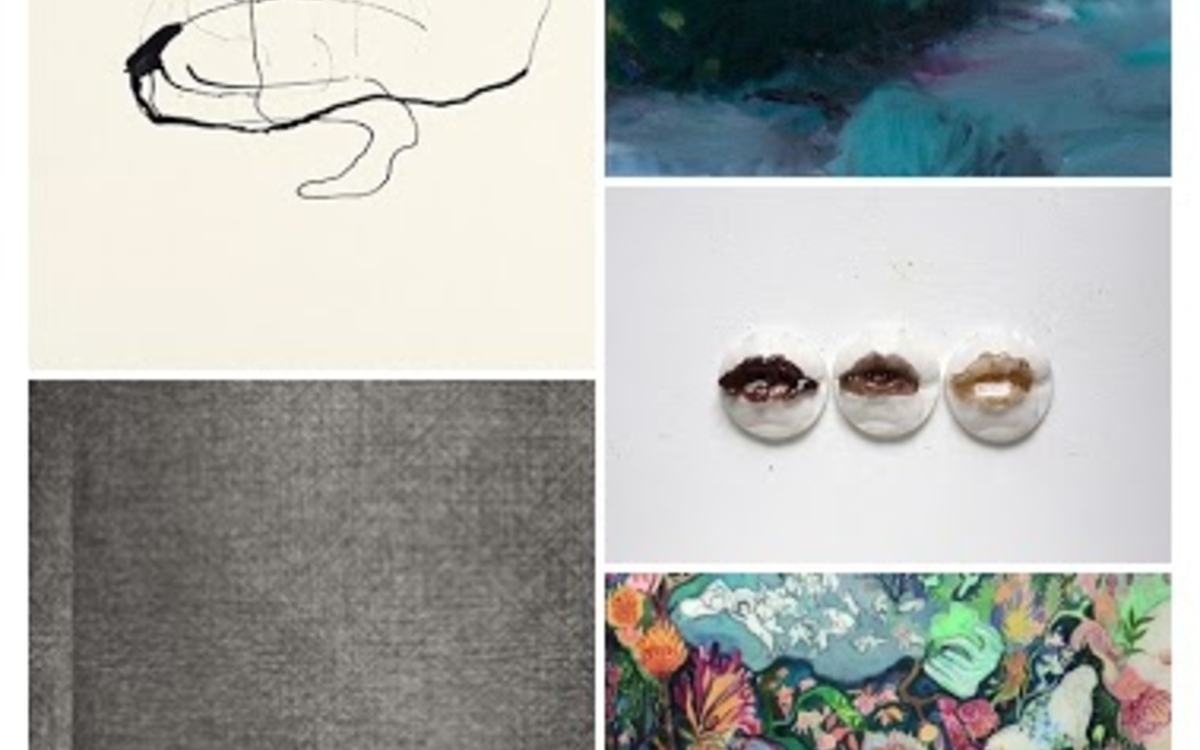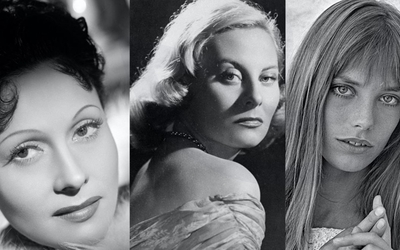Cette Exposition permet aux Artistes ayant exposé les années précédentes d’avoir l’opportunité d’un deuxième Rendez-vous
Nous avons le plaisir en cette rentrée d’ouvrir nos portes à : Tamaris Borrelly, Aurélie Denis, Maximilien Hauchecorne, Juliette Vivier et Longjun Zhang.
Tamaris Borrelly : Souvent, enveloppés dans un brouillard très doux et duveteux, des êtres animés, des plantes et des pierres se blottissent et se serrent les uns contre les autres, comme s’ils fusionnaient en un seul corps.
Parfois, la matière semble jouer d’elle-même, faire montrer de sa puissance ou chercher frénétiquement un état qui lui convienne : le béton et la peau ne font qu’un ; le sol devient montagne, puis mille êtres, puis un seul, une forêt, une forme fantasmatique, et redevient poussière. La poussière recommence, dans un autre ordre. La matière rejoue la genèse, le cycle des réincarnations, ou Babel. Puis elle se joue des mythes et de nous, qui tentons d’y lire ce qu’on connaît déjà, d’y apposer des schémas narratifs pré-établis.
On entre ici dans un monde qui ne s’accommode pas de schémas et de catégories. On y perçoit pourtant plusieurs langages, de ceux que Walter Benjamin considérait « sans noms, sans acoustiques, faits de matière ». Les osmoses et les métamorphoses constantes y floutent et atténuent les contours des mots qui trient et séparent les êtres et les choses. Les apparences et le visible y sont à la fois tout, et rien, puisque que les corps n’ont pas délimitations, que les formes ne sont pas figées.
Ce monde contient des questions. Elles ne sont pas pressantes et frontales. Ce ne sont pas des questions élaborées avec des mots, ce sont des questions façonnées par les formes et la matière, qui baignent dans une brume tiède, organique.
En floutant les limites entre les êtres et les choses, l’espace et le temps le travail de Tamaris Borrelly appelle à la rêverie métaphysique. Les langages qu’elle emprunte, faits de matière souvent organique et mouvante questionnent la matérialité et la substance des choses. Ils nous rappellent que les molécules peuvent s’assembler en une multitude d’éléments, que le fer dans la terre peut constituer une roche, qu’il peut couler dans nos veines, dans celles de l’oiseau et du rat, ou circuler dans la sève d’un arbre. Mais ils ne font pas simplement référence aux règles qui régissent notre monde, ils s’en affranchissent pour s’autoriser toutes les hybridations, toutes les transfigurations. La nature y est retranscrite rêvée et magnifiée, luxuriante. Elle n’est pas simplement esthétisée, elle parle de l’espace, du vide, du temps, de la matière, des choses et de leurs délimitations, du début et de la fin.
Aurélie Denis : Auteure et plasticienne, Aurélie Denis vit et travaille à Paris. Sa pratique fait entrer en résonnance écriture, dessin et performance ; c’est une enquête sur les trajectoires, les temporalités et les potentialités d’un corps. Dans ses performances et sa danse, elle joue avec le contrôlé et l'incontrôlé, le geste maîtrisé et le réflexe, la lenteur et les accélérations. Les mouvements et le placement de son corps dans l'espace sont le fruit d'un travail raisonné, d'une compréhension fine des sensations internes, la proprioception.
Lors de ses études à la HEAR (Haute École des Arts du Rhin, Strasbourg), puis à la Saint Martins College of Art (Londres), Aurélie Denis met en scène ses sculptures et son propre corps dans ses performances et ses photographies. Elle puise dans son quotidien des éléments qu’elle intègre à sa recherche formelle.
Elle se tourne vers l’écriture et la lecture-performance pour construire un récit autofictionnel sur la réappropriation de son corps après un accident survenu à Londres. Le Taxi est publié en 2010 aux éditions Esperluète.
Partir d'un même corps, multiplier les angles d'approche : La pratique quotidienne du dessin amène l’artiste, par le ralentissement du geste et sa répétition, à une perception accrue du mouvement et de son anticipation. Cette expérience, étendue à d’autres gestes (la marche notamment), est de nouveau retranscrite dans ses encres de Chine.
Suivant le principe de transversalité et de porosité qui caractérise son travail ( de l'oralité à l'écriture, de l'écriture au dessin, du dessin au mouvement, du mouvement à la scène…) Elle adapte son livre Le Taxi dans un seul en scène, Le corps parle, qu'elle joue au Festival, Les Mises en Capsule, au Ciné 13 Théâtre à Paris.
Elle approfondit l’expression scénique au sein du Théâtre du Mouvement, lors de stages professionnels – théâtre, mime, danse – avec la compagnie de Claire Heggen et Yves Marc, et poursuit sa recherche lors de performances associant corps et texte. Elle participe à différents festivals de performance.
Au sein du trio CorpsBruits, elle interagit avec les sons produits par les musiciens Xavier Mussat et Niels Mestre.
CorpsBruit a été programmé pour le festival La semaine du bizarre, 2021, au Théâtre Berthelot à Montreuil.
Aurélie Denis a récemment écrit et joué la performance solo Gravida sur une musique acousmatique de Jorge Antunes, pour le festival En chair et en son.
Maximilien Hauchecorne : Utilisant l’encre de Chine et la plume, parfois sur un tirage cyanotype, les dessins de Maximilien Hauchecorne commencent par un noir intense, introduisant une géométrie raffinée sur le blanc du papier. L’aube commence par l’obscurité, et l’architecture déploie ainsi une intégration lente et régulière de la lumière, révélant des formes cylindriques aux formes elliptiques variées. Des couches successives de lignes tracées à main levée explorent une préoccupation pour le volume au-delà de ces seules formes, son corpus d’œuvres s’étendant sur une vaste échelle, de 180 cm à la largeur d’une paume. Les cahiers qui se déplient et se déplient à nouveau en une multitude de croquis du monde naturel, imitant la narration du flux de conscience rendue célèbre par «Mrs. Dalloway» de Virginia Woolf.
Dans les eaux-fortes, les vagues de l’océan sont représentées avec la douceur d’une plume, montant et descendant de la page comme une poitrine et un ventre remplis d’air. Ces paysages marins témoignent d’une pratique qui n’est pas confinée à la sécurité d’un environnement contrôlé, mais qui s’adapte et s’étend dans la poursuite de la maîtrise. Son raffinement artistique croît parallèlement à la profondeur spirituelle, manifestant un niveau de précision que l’on confond parfois (de manière quelque peu ironique) avec ce qui doit être généré par ordinateur.
Maximilien Hauchecorne fait un geste vers les irrégularités que la lumière projette dans son travail, des nuances et des motifs tissés dans les superpositions successives, qui sont indéniablement humaines. Inspiré par l’ouvrage « L’Éloge de l’Ombre » de Jun’ichiro Tanizaki, sa pratique témoigne d’une volonté de prendre conscience de la richesse de notre expérience quotidienne, si ces textures et transitions – de l’ombre à la lumière et inversement – peuvent être ressenties dans l’instant vécu.
Juliette Vivier : Juliette Vivier joue avec les images et avec les matières dans un va-et-vient qui évolue du fragment au grand paysage. Elle expérimente les interactions entre œuvre unique et multiple. Elle nous donne à voir les milieux naturels sous toutes leurs qualités morphologiques. Récemment, ses œuvres en céramique nous mènent
vers une dimension plus corporelle tout en nous invitant
à un contact avec les matières.
Son exposition se livre par indices à déceler au fur
et mesure que l’on explore des correspondances entre
ses travaux artistiques. Elle propose un jeu de questions/réponses.
En passant d’un espace à un autre, tel un archéologue, nous établissons des liens entre les différentes séries d’œuvres. Nos expériences esthétiques vacillent entre
un moment ludique et une approche plus scientifique.
L’artiste déploie un corpus de travaux sur papier et
en volume réalisés en diverses techniques et matériaux. Chaque expérience en engendre de nouvelles et la conduit à poursuivre un travail où elle associe des éléments entre-deux.
Son approche expérimentale de l’estampe fait émerger
un travail combinatoire. Attentive, empruntant la posture du géologue, son intérêt pour les reliefs oscille du micro au macrocosme. En observant de près les milieux qui incarnent le passage du temps, elle fait ressortir des couches de mémoire. L’artiste cherche ainsi à rendre compte de territoires sous plusieurs angles et rend perceptibles des évolutions des paysages.
Les montagnes ou les grottes, comme dans ses sérigraphies de la série Spéléothèmes, se révèlent fortes et fragiles, en cours d’érosion par endroit. Une tension entre calme et désordre se révèle en contemplant chaque œuvre sur papier. Une certaine sensualité en émane également.
Les plissements semblent ainsi se protéger entre eux. Un nuage coloré dévoile les cavités, qui apparaissent mystérieuses. Des présences fantomatiques surgissent.
Les variations de couleurs créent un état intermédiaire entre rêve et cauchemar. Ses œuvres nous invitent également à créer de nouvelles associations visuelles
afin de laisser venir de possibles constructions de paysages et songer à leurs transformations.
Une métamorphose est aussi à l’œuvre dans sa série de tornades, Echelle de Fujita et Buisson de la Trombe. L’artiste allie un bouleversement dans le paysage par des découpages réguliers. Ses séries offrent en ce sens une infinité de combinaisons possibles, écho aux multiples transformations des paysages anciens, au fil des saisons et des années.
Juliette Vivier compose des récits à partir d’agencements d’images qui s’incarnent en prenant le temps de les observer. Vide et plein, minéral et végétal, organicité et rigueur des lignes, ces dialectiques formelles et naturelles se retrouvent dans les œuvres de l’artiste.
Elle poursuit ses actions manuelles, approches des matières, en expérimentant la céramique. Ses crânes
sont supports à de multiples interventions. Elle les re-pare, leur donne une nouvelle identité, les voile, les révèle et suggère la forme en volume. Vanités teintées d’humour, ses sculptures constituent des reliques et incarnent une forme de vie.
Le paysage et le corps s’interpénètrent dans ses œuvres sur papier et en volume. Les cavités des montagnes apparaissent tels les plis de corps. Ce qui rappelle une certaine esthétique baroque. Tentative d’atteindre des sommets et pourtant le danger est bien là… Vie et mort, milieu sauvage et maîtrisé, cadrage et décadrage, ces associations opposées, en équilibre, émanent de ses œuvres en série.
Elle s’en saisit pour donner naissance à des formes ambigües : ses empreintes de fragments de corps humains deviennent des Blasons, matières précieuses
que l’on porterait sur soi, pour leurs propriétés curatives.
Les bouquets de fleurs fanées symbolisent également des memento-mori délicats, le passage du temps auquel Juliette Vivier porte son attention. Nous devons aiguiser notre perception pour reconnaître la silhouette de cette nature morte, que nous sommes invités à regarder avec finesse.
La question de la photographie, de la reproductibilité et
de la diffusion s’incarne dans cette série en cours nommée avec humour To be or not to be.
Ainsi, Juliette Vivier nous incite à prêter attention à
des milieux naturels inatteignables, cachés. Elle revisite la dualité vie et mort, organicité et minéralité. Son exposition unit regard scientifique et plaisir du jeu de rapprochement d’images, d’idées. De nouveaux mondes, quelque peu équivoques, s’ouvrent à ceux qui prendront le temps de faire plusieurs fois le tour de cet accrochage, en mouvement.
Longjun Zhang : Les thèmes chers à Longjun Zhang sont les paysages, les objets du quotidien, les hommes…
Un homme est affalé dans un fauteuil, deux autres se mettent nus, un autre est assis face à nous prenant appui sur ses coudes, d’autres s’étreignent. L’homme marque là le point de tangence du vide et de la stabilité. Leur irréciprocité, sauf un couple qui s’enlace, est génératrice d’interrogation presque de mystère.
Que font-ils ? Ils semblent évoluer sans nous remarquer, presque dans un vide marqué par la couleur ou plutôt la non-couleur – le noir, le gris, le blanc – qui permettent l’approfondissement du sujet sur la toile, même si le noir a la propriété d’en aggraver les formes. Les toiles se cherchent dans la confrontation de ces corps, dans le débat entre les diverses inhibitions et censures que l’homme s’attribue à lui-même. Des figures pourtant désirantes faites souvent à partir de photos prises sur internet.
Les paysages sont plus apaisés. À la première lecture, ces déserts où toute présence humaine est effacée jettent le trouble tant l’image picturale, par une puissance qui frappe le regard, garde ses distances avec un regardeur possible. Les couleurs souvent presque sourdes réagissent à l’intérieur de leur propre lumière aux limites d’un silence et d’un calme apaisant. L’usage de la brosse et de pinceaux de différentes tailles permet à la peinture de se déployer et de faire surgir des transparences et une cosmogonie écrite dans les ombres et les lumières.
À ces deux séries bien identifiées, s’ajoutent des toiles de petit format sur la thématique de la main. Dotées d’une grande puissance suggestive, elles traduisent l’expression des sentiments et de la pensée, rappelant que dans la pratique de la peinture occidentale et de la calligraphie chinoise que Longjun connaît bien, la main qui tient le pinceau est une mémoire sans paroles, une mémoire d’expérience, faite de transmission, et fondée sur une accumulation d’apprentissages et d’oublis.
Il ne faudrait pas croire que la peinture de Longjun Zhang n’est faite que d’ombres et de violence. À y regarder de plus près, le peintre fait surgir des formes où la charge émotionnelle est tellement forte qu’elle peut sembler parfois assourdissante. Elle est en tous cas éclairée par une pensée très pure et forte qui s’immerge dans les formes peintes. Ses toiles peuvent évoquer Munch, Goya, Manet, plus récemment Joan Mitchell ou Marlène Dumas que Longjun Zhang aime à citer comme ses maîtres mais elles ne répètent jamais aucun modèle. Ses tableaux nous happent et nous nous laissons baigner par cette peinture majestueusement déployée où il nous incite à entrer.