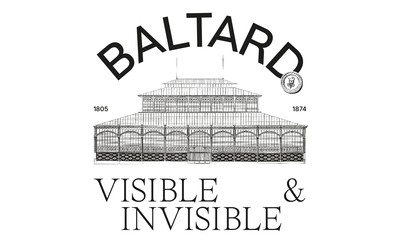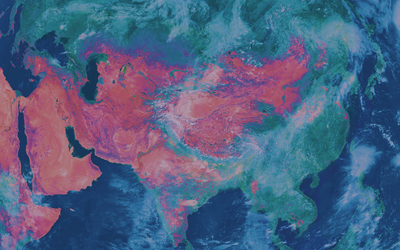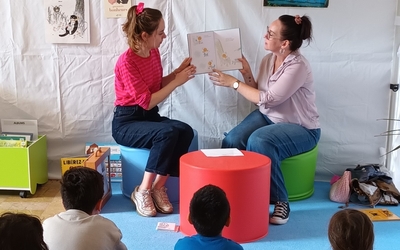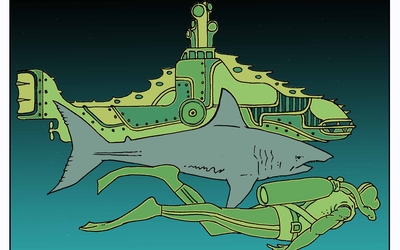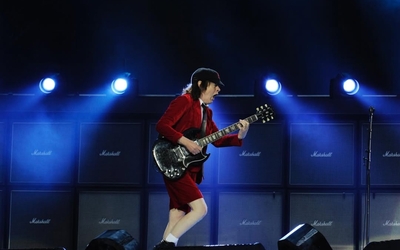Cet évènement fait partie de
Les jeudis de l'actualité
« La criminalité environnementale est devenue en quelques années l’une des activités criminelles les plus lucratives au monde. Extrêmement lucrative et peu risquée, elle rapporterait entre 110 et 281 milliards de dollars par an », avertit le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Elle « désigne l’ensemble des
activités illégales qui portent atteinte à l’environnement et profitent à
certains individus, groupes et /ou entreprises », poursuit-il, avant
de distinguer cinq catégories officiellement reconnues : le commerce
illégal d’espèces sauvages, l’exploitation forestière illégale, la pêche
illégale, le déversement et le commerce illégaux de déchets et substances dangereux
et toxiques, l’exploitation et le commerce illégal de minerais.
Les contours et
le contenu du phénomène semblent tout à
fait clairs. Et s'ils ne l'étaient pas ?
Si une telle conception
escamotait au contraire l'essentiel, à savoir la délimitation et la
qualification des atteintes au vivant qui méritent d'être rejetées dans
l'illégalité, pendant que d'autres seront considérées comme acceptables ?
La séparation entre ce qui doit être toléré ou non ne va en effet pas de soi,
encore moins au beau milieu d'un bouleversement écologique… Comment est fixée
la limite entre les pollutions ou les dégradations légitimes et illégitimes ?
Qui la trace, cette limite, et selon quels critères, quelles conventions, quels
principes ?
À partir de quelles croyances, en fonction de quelles stratégies ?
Quels intérêts se trouvent par là menacés ou au contraire ménagés ?
C’est
autour de ces questions brûlantes que cette rencontre propose de débattre.
Avec Grégory Salle, directeur de recherche
au CNRS, affecté au Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et
économiques (Clersé), situé au sein de l'Université de Lille.